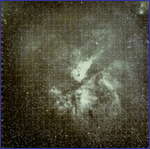![]() a carte photographique du Ciel
a carte photographique du Ciel
Hors de France, les catalogues continuent à fleurir. Maintenant ils indiquent non seulement l'ascension droite et la déclinaison, comme aussi la magnitude, de chaque étoile, mais aussi son type spectral. Ainsi, à Harvard, le catalogue Henry Draper (HD) (1918-1924) de Edward Pickering, contient-il plusieurs centaines de milliers d'étoiles. En France, la postérité de Lalande s'est orientée plutôt vers la détermination, par les observations méridiennes, de la position des étoiles fondamentales, réseau des étoiles de référence plus brillantes. C'est surtout vers les opérations originales de photographie astronomique que l'on se dirige. Mouchez, directeur de l'Observatoire de 1878 à 1892, soucieux de réaliser une carte photographique complète du ciel, constate le 18 janvier 1886, devant l'Académie des sciences, que la France, ne peut seule exécuter la Carte du Ciel ; cette oeuvre était d'un intérêt scientifique universel. Il réussit alors à convaincre l'Académie des sciences de provoquer une réunion internationale chargée du choix des stations et de l'équipement, et de l'adoption d'une même échelle et d'une même méthode. Il est décidé de photographier en 22.000 clichés la totalité du ciel, le travail étant réparti, d'Helsinki à Melbourne, entre 10 observatoires de l'hémisphère austral, dont Paris, Bordeaux, et Toulouse, et 9 de l'hémisphère boréal. Maurice Loewy est un des acteurs importants du projet international ; après Mouchez, il préside la Commission Permanente internationale de la Carte du Ciel. Benjamin Baillaud, devenu directeur de l'Observatoire en 1907, s'évertue à faire fonctionner l'opération. Elle devait devenir l'un des germes de l'Union Astronomique Internationale, créée en 1919, et s'y fondre.